retour au sommaire étude d'impact
2) Contenu
de l'étude d'impact sur l'environnement d'ouvrages maritimes
L'étude d'impact est un
document de synthèse qui est l'aboutissement des études
d'environnement faites dans le cadre d'un avant-projet,
parallèlement aux études techniques et économiques. Cette
synthèse est effectuée à l'instant où le dossier est
établi. Les études d'environnement doivent commencer en
amont et se poursuivre en aval, avec un niveau de précision
allant grandissant, tous les détails ne pouvant être
arrêtés au terme de l'étude d'impact.
L'étude d'impact pourra
aborder les aspects suivants, en développant tel ou tel
point selon l'importance des travaux d'aménagement
projetés, et leur incidence prévisible sur l'environnement
:
2.1) Description du projet


Le but de cette première
partie est de définir sommairement le projet envisagé. Il
faudra notamment préciser l'objectif de l'opération, la
localisation de l'ouvrage ainsi que sa description
générale. Une analyse des coûts et un échéancier
prévisible de réalisation peuvent aussi compléter cette
description.
2.2) Analyse de
l'état initial
La description de l'état
initial doit porter sur le site retenu pour l'implantation
des équipements, mais aussi éventuellement sur les sites
envisagés pour les alternatives et les variantes
d'aménagement. Le périmètre d'étude doit être
suffisamment large pour permettre une analyse
cohérente des facteurs environnementaux.
Les différents thèmes
d'étude concernent le milieu physique, le milieu naturel,
les sites et paysages, et le contexte humain et
socio-économique.
a) Le milieu
physique
L'aire d'étude comprendra
l'ensemble de la frange littorale proche, sur laquelle
l'ouvrage pourra avoir une influence.
- données
météorologiques : répartition statistique des
vents par direction et vitesse
- données
océanographiques : houle, marées, courants,
bathymétrie
- données géologiques et
géomorphologiques
- données
sédimentologiques et dynamiques du littoral
- données hydrologiques
b) Le milieu
naturel
L'étude du milieu naturel doit
permettre d'établir un état initial du milieu vivant, mais
aussi servir de base à l'évaluation des impacts.
- environnement marin : faune et
flore, "qualité" du milieu
- environnement terrestre : faune
ornithologique, flore
c) Sites et
paysages
L'objectif est ici de définir
l'intérêt écologique et paysager du site, afin de mieux
appréhender les rapports qui s'établiront entre l'ouvrage
maritime et son environnement, et d'apprécier les effets
durables sur le paysage préexistant.
d)
Contexte humain et socio-économique

La connaissance des
caractéristiques humaines et socio-économiques du lieu
d'implantation d'un ouvrage maritime a une importance
particulière, car ce type d'équipement peut bouleverser la
vie économique locale, notamment par une augmentation du flux
touristique, des
incidences sur le fonctionnement urbain, ou encore une
concurrence exercée vis-à-vis d'autres pôles d'activités
plus traditionnels.
Cette étude sera réalisée
à l'échelle de la commune d'implantation de l'ouvrage, et
la réflexion sera engagée à deux niveaux :
- à un niveau général,
par le biais de l'examen de documents d'aménagement
ou d'urbanisme (plan d'occupation des sols)
- au niveau local, par le
biais d'une enquête communale permettant de faire
ressortir la situation économique et son évolution
prévisible.
La méthode générale
d'investigation sera celle des enquêtes auprès des
différents services administratifs régionaux ou locaux, des
élus locaux et des représentants des groupes sociaux
intéressés. Elle portera sur
plusieurs domaines:
- données générales :
démographie, occupation et utilisation de l'espace,
profil économique
- activités : industries,
pêche
- urbanisme : occupation du
sol, circulation et stationnement, centres
d'activités et d'animation
retour au
sommaire contenu de l'étude
2.3) Analyse
des effets sur l'environnement
L'analyse des incidences d'un
ouvrage maritime s'intéressera à toutes les phases de la
vie du projet : période de construction, d'exploitation et
d'entretien.
a) La période
de chantier
Des impacts
sérieux peuvent
être occasionnés durant cette période transitoire. Ils
peuvent avoir une forte rémanence dans le temps, leurs
effets n'étant pas toujours limités à la durée des
travaux, et couvrir une zone plus étendue que la simple
emprise de l'ouvrage.
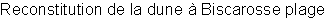

Les principaux impacts
envisageables sont :
- milieu marin :
dégradation de la qualité des eaux (pollution),
influence sur la pêche et le tourisme
- milieu terrestre :
modification des paysages, dégradation de la
végétation
- cadre de vie : qualité
de l'air, bruits et vibrations, gêne pour la
circulation
b) Le
fonctionnement de l'ouvrage
Environnement
physique :
Les effets dus aux
modifications des conditions de houle, de courants et du
régime sédimentaire se manifestent aux abords de l'ouvrage,
mais également à distance. Une première approche
d'expertise peut être réalisée sur la base des données
recueillies dans la phase de l'état initial, mais il est
nécessaire de mener une étude spécifique à l'aide de
modèles mathématiques dès que le phénomène devient
complexe.
Les impacts possibles sont :
- effets sur la propagation
de la houle : diffraction et réflexion
- modification des courants
- modification des
conditions sédimentologiques : effets sur le trait
de côte, ensablement
L'exploitation des modèles
mathématiques permet d'optimiser les caractéristiques
dimensionnelles de l'ouvrage et de réduire les effets
d'érosion.
- Milieu naturel : impacts directs et indirects sur la
faune et la flore, la qualité des eaux et des
sédiments
- Valeur
paysagère du site : au
plan général (apport d'éléments artificiels,
constructions annexe...), au plan particulier
(succès ou échec de l'intégration des
aménagements)

- Contexte humain
et socio-économique :
emplois directs (chantier) et indirects, tourisme,
finances locales, compatibilité avec d'autres
secteurs d'activité, développement urbain
(circulation et stationnement)
c) Les travaux
d'entretien : extraction de sédiments...
retour au
sommaire contenu de l'étude
2.4)Raisons du choix du projet retenu
Cette partie a pour objectif
de montrer que le projet a été étudié avec le souci de préserver au
maximum l'environnement. Il convient donc dès le stade des études
d'environnement d'envisager différentes stratégies et
variantes d'aménagement et d'en évaluer les impacts.
Dans tous les cas, il
conviendra de développer comme alternative l'hypothèse du
maintien du site dans son état naturel. On observera en
outre que les impacts sur l'environnement d'un projet ne sont
pas tous négatifs.
Les méthodes de
comparaison des
partis d'aménagement sont:
- approche unicritère
agrégée : impacts ramenés à une valeur monétaire
- approche multicritère
non agrégée : chaque impact est comparé à un
seuil critique, et les variantes sont rejetées si
elles dépassent les normes
- approche multicritère
agrégée ...
Les choix effectués devront
être expliqués en montrant les raisons économiques,
techniques et environnementales ayant concouru à la
définition du parti présenté. Les décisions quant au
choix du projet parmi les divers partis envisagés relèvent
de la responsabilité du maître d'ouvrage. Il lui appartient
cependant de préciser les raisons qui l'ont amené à cette
décision.Il doit se conformer aux diverses prescriptions
d'ordre législatif et réglementaire applicables (loi de
protection de la nature et loi "littoral" notamment).
2.5) Mesures
compensatoires
Il s'agit d'exposer les
mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les
conséquences dommageables du projet et l'ordre de grandeur
des dépenses correspondantes.
Les mesures compensatoires
interviennent lorsqu'un impact ne peut être réduit ou
supprimé. La mise en oeuvre de ces mesures a pour objet
d'offrir une contrepartie aux effets dommageables. Celle-ci se caractérise par la
"distance" spatiale et temporelle entre l'impact et
le compensation proposée :
- distance dans l'espace :
on détruit ici, on reconstruit là
- distance dans le temps :
on détruit maintenant, on reconstruira plus tard
- distance entre la nature
de l'effet et celle du remède : on dégrade ici, on
améliore ailleurs
Il est important de
privilégier la mise en oeuvre de mesures de suppression ou
de réduction des impacts avant de faire intervenir des
mesures compensatoires.
Il peut s'agir de plantations,
de chemins piétonniers, de réutilisation de zones
libérées...
retour au
sommaire contenu de l'étude
retour au
sommaire étude d'impact




